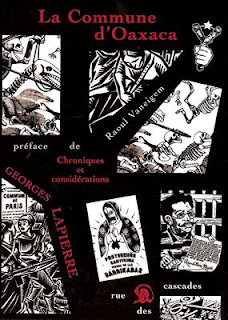Cette contradiction entre le fond positif et incontestable des idées libertaires et l'état misérable où végète le mouvement anarchiste, trouve son explication dans un ensemble de causes dont la plus importante, la principale, est l'absence de principes et de pratiques organisationnels dans le monde anarchiste.
Dans tous les pays le mouvement anarchiste est représenté par quelques organisations locales préconisant une théorie et une tactique contradictoires n'ayant point de perspectives d'avenir ni de continuité dans le travail militant, et disparaissant habituellement presque sans laisser la moindre trace derrière eux.
Un tel état de l'anarchisme révolutionnaire, si nous le prenons dans son ensemble ne peut être qualifié autrement que comme une "désorganisation générale chronique".
Telle la fièvre jaune, cette maladie de la désorganisation s'est introduite dans l'organisme du mouvement et le secoue depuis des dizaine d'années.
Il n'est pas douteux toutefois que cette désorganisation a sa source dans quelques défectuosités d'ordre théorique: notamment dans une fausse interprétation du principe d'individualité dans l'anarchisme; ce principe étant trop souvent confondu avec l'absence de toute responsabilité. Les amateurs de l'affirmation de leur "Moi", uniquement en vue d'une jouissance personnelle, s'en tiennent obstinément à l'état chaotique du mouvement anarchiste et se réfèrent, pour le défendre, aux principes immuables de l'anarchisme et de ses maîtres.
Or, les principes immuables et les maîtres démontent justement le contraire.
La dispersion et l'éparpillement, c'est la ruine. L'union étroite, c'est le gage de la vie et du développement. Cette loi de la lutte sociale s'applique aussi bien aux classes qu'aux partis.
L'anarchisme n'est pas une belle fantaisie, ni une idée abstraite de philosophie: c'est le mouvement social des masses laborieuses. Pour cette raison déjà, il doit rallier ses forces en une organisation générale constamment agissante, comme l'exigent la réalité et la stratégie de la lutte des classes.
"Nous sommes persuadés, dit Kropotkine, que la formation d'un parti anarchiste en Russie, loin d'être préjudiciable à l'oeuvre révolutionnaire est au contraire souhaitable et utile au plus haut degré" (préface à la "Commune de Paris" par Bakounine éditions de 1892).
Bakounine ne s'opposait jamais non plus à l'idée d'organisation anarchiste générale. Au contraire, ses aspirations concernant l'organisation ainsi que son activité dans la première internationale ouvrière nous donne tous les droits de voir en lui un partisan actif, précisément, d'une telle organisation.
En général, tous les militants actifs, ou presque, de l'anarchisme combattirent toute action éparpillée et songèrent à un mouvement anarchiste soudé par l'unité du but et des moyens.
C'est pendant la révolution russe de 1917 que la nécessité d'une organisation générale se fit sentir le plus nettement et le plus impérieusement. Ce fut au cours de cette révolution que le mouvement libertaire manifesta le plus haut degré de démembrement et de confusion. L'absence d'une organisation générale amena beaucoup de militants actifs de l'anarchisme dans le rangs des bolchéviks. Elle est la cause de ce que beaucoup de militants restent actuellement dans un état de passivité, empêchant toute application de leurs forces qui sont souvent d'une grande importance.
Nous avons un besoin vital d'une organisation qui, ayant rallié la majorité des participants au mouvement anarchiste, établirait dans l'anarchisme une ligne générale tactique et politique, qui servirait de guide à tout le mouvement.
Il est temps pour l'anarchisme de sortir du marais de la désorganisation, de mettre fin aux vacillations interminables dans les questions théoriques et tactiques les plus importantes, de prendre résolument le chemin du but clairement conçu, et de mener une pratique collective organisée.
Il ne suffit pas, cependant, de constater la nécessité vitale d'une telle organisation, il est nécessaire encore d'établir la méthode de sa création.
Nous rejetons comme théoriquement et pratiquement inapte l'idée de créer une organisation d'après la recette de la "synthèse", c'est à dire réunissant des représentants des différentes tendances de l'anarchisme. Une telle organisation ayant incorporé des éléments théoriquement et pratiquement hétérogène ne serait qu'un assemblage mécanique d'individus concevant d'une façon différente toutes les questions du mouvement anarchiste, assemblage qui se désagrégerait infailliblement à la première épreuve de la vie.
La méthode anarcho-syndicaliste ne résoud pas le problème d'organisation de l'anarchisme, car elle ne donne pas la priorité à ce problème, s'intéressant uniquement à sa pénétration et à son renforcement dans les milieux ouvriers.
On ne peux cependant pas faire grand chose dans ces milieux, même en y prenant pied dans une certaine mesure, si l'on ne possède pas une organisation anarchiste générale.
L'unique méthode menant à la solution du problème d'organisation générale est, à notre avis, le ralliement des militants actifs de l'anarchisme sur la base de positions précises: théoriques, tactiques et organisationnelles, c'est à dire sur base plus ou moins achevée d'un programme homogène.
L'élaboration d'un tel programme est l'une des tâches principales que la lutte sociale des dernières années impose aux anarchistes. C'est à cette tâche que le groupe d'anarchistes russes à l'étranger consacre une part importante de ses efforts.
La "Plate-forme d'organisation" publiée ci-dessous représente les grandes lignes, l'armature d'un tel programme. Elle doit servir de premier pas vers le ralliement des forces libertaires en une seule collectivité révolutionnaire active, capable d'agir: l'Union générale des Anarchistes.
Nous ne nous faisons pas d'illusions sur telle ou telle lacune de la présente Plate-forme. Sans aucun doute, en a-t-elle, comme du reste toute démarche pratique nouvelle d'une certaine importance. Il se peut que certaines positions essentielles y soient omises, ou que certaines autres y soient insuffisamment traitées, ou que d'autres encore y soient, au contraire, trop détaillées ou trop répétées. Tout cela est possible. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est de jeter les fondements d'une organisation générale. Et c'est ce but qui est atteint, à un degré nécessaire par la présente Plate-forme.
C'est à la collectivité entière - l'union des anarchistes - de l'élargir, de l'approfondir, plus tard d'en faire un programme définitif pour tout le mouvement anarchiste.
Sur un autre plan aussi, nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous prévoyons que plusieurs représentants du soit-disant individualisme et de l'anarchisme chaotique nous attaqueront la bave aux lèvres, et nous accuseront d'avoir enfreint les principes anarchistes.
Nous savons cependant que les éléments individualistes et chaotiques comprennent sous le titre de "principes libertaires" et "je m'en foutisme", la négligence et l'absence de toute responsabilité, qui portèrent à notre mouvement des blessures presque inguérissables et contre lesquelles nous luttons avec toute notre énergie, toute notre passion. C'est pourquoi nous pouvons en toute tranquillité négliger les attaques venant de ce camp.
Nous fondons nos espoirs sur d'autres militants: sur ceux qui restés fidèles à l'anarchisme, ayant vécu et souffert la tragédie du mouvement anarchiste, cherchent douloureusement une issue.
Et puis nous fondons de grandes espérances sur la jeunesse libertaire qui, née sous le souffle de la révolution russe et prise, dès le début, dans le cercle des réalités concrètes exigera certainement la réalisation de principes organisationnels et constructifs de l'anarchisme.
Nous invitons toutes les organisations anarchistes russes dispersées dans les divers pays du monde et aussi les militants isolés de l'anarchisme à s'unir en une seule collectivité révolutionnaire, sur la base d'une Plate-forme commune d'organisation.
Puisse cette plateforme servir de mot d'ordre révolutionnaire et de point de ralliement à tous les militants du mouvement anarchiste russe!
Puisse-t-elle poser les fondements de l'Union Générale des Anarchistes!
VIVE LA RÉVOLUTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS DU MONDE.
Groupe DIELO TROUDA
Paris, 20 juin 1926