Saisir la question du communisme
Version intégrale du texte de nos camarades de » il lato cattivo »
Remerciements à Stive pour la traduction, à Alain pour les corrections et à l’auteur pour la relecture
« Qestion Kurde », Etat islamique, USA et autres considérations
Il Lato Cattivo
Le texte qui suit a été initialement prévu pour une rencontre publique – qui s’est tenue à Bologne, début septembre 2014 – avec Daniele Pepino, auteur de l’article « Kurdistan, dans l’œil du cyclone » (dans Nutanak, n° 35, été 2014). N’ayant pu participer à cette rencontre, nous avons, ultérieurement, remanié le texte initial ; ce qui en résulte peut être lu soit comme une série de notes en marge de l’article de Pepino, soit comme un texte indépendant.
« Kurdistan, dans l’œil du cyclone » a le mérite de présenter d’une façon claire le cadre des forces politiques qui interviennent dans la région kurde ; mais l’article appelle une série de questions qu’il faut souligner. Au-delà de la simple mise en valeur de l’intervention des milices du PKK dans leur soutien aux kurdes yezidi menacés par l’EI dans le nord de l’Irak, l’auteur procède à une véritable apologie de cette organisation et de son prétendu tournant d’ « ouverture » (le confédéralisme démocratique). De plus, l’absence d’une description des forces sociales et des organisations qui en sont les expressions politiques, tend à faire apparaître leurs interventions comme comme de simples choix subjectifs opérés par des individus socialement indéterminés. Enfin, entre autres questions, celles du financement du PKK ou des alliances qui caractérisent le Moyen-Orient sont trop rapidement évoquées.
Il est vrai que pour aborder ces questions de manière plus complète il faudrait écrire plusieurs livres. Bien entendu, les notes qui suivent ne manqueront pas de rester lacunaires. Mais nous pensons qu’elles peuvent éclairer sous un axe différent aussi bien les récentes évolutions de la « question kurde » que les conflits qui enflamment, encore une fois, le Moyen-Orient. Sans oublier que si cela peut avoir une utilité quelconque pour nous ou pour d’autres, leur intérêt réside dans le fait de saisir, non la question de l’ « autonomie » (quoi qu’elle puisse signifier), mais celle du communisme.
Question kurde : une digression historique
L’émergence d’une « question kurde » spécifique, à la fin de la Première Guerre mondiale, est à inscrire dans le processus chaotique de la formation des États-nations dans le Proche et Moyen-Orient. Partout, la formation d’un État-nation moderne implique la nécessité de faire coïncider les frontières administratives de l’État avec celles d’une unique communauté nationale ; les États plurinationaux représentent généralement des situations problématiques ou exceptionnelles : l’État-nation, c’est-à-dire l’État du Capital, est mono-national, parce que le rapport entre les individus et l’État mis en avant ne peut tolérer une fidélité à une autre communauté que celle que prétend représenter l’État-nation. État et nation doivent alors coïncider. Un tel processus n’a rien de « naturel », c’est un processus d’homogénéisation qui peut relever du bricolage et prendre des formes d’assimilation soft, comme il peut utiliser la purification ethnique la plus brutale. S’il est vrai que pour l’Europe le puzzle de populations fut plus moins un obstacle que pour les Balkans ou le Moyen-Orient, la raison n’en réside pas tant dans l’importante ou faible complexité ou dans le caractère inextricable du puzzle en soi, mais dans le fait que si en Europe la formation des États-nations s’est faite sur l’impulsion du développement d’un capitalisme endogène, rendu possible par la succession bien définie des modes de production antérieurs, dans les Balkans et le Moyen-Orient cette formation s’est faite selon un développement capitaliste venant d’ailleurs, avec les rivalités intercapitalistes qui en ont découlé. À la suite du démembrement de l’Empire Ottoman, dont les puissances victorieuses (Grande-Bretagne et France) se partagent les dépouilles, il y a la création de l’Irak et de la Syrie que Britanniques et Français mettent sous mandat, et d’autre part celle de la Turquie avec l’ascension du mouvement nationaliste de Mustapha Kemal (Atatürk). Ce dernier se trouve immédiatement confronté au caractère plurinational du futur État turc (Turcs, Kurdes et Grecs d’Anatolie), question sommairement simplifiée par l’extermination des Arméniens en 1915-16 par les « Jeunes Turcs » (1 200 000 morts). Quant aux Kurdes, le traité de Sèvres du 10 août 1920 consignait la possibilité de créer un petit Kurdistan indépendant, à condition que cela corresponde à la volonté collective de la population kurde, ainsi que la formation d’un État arménien à partir d’une des provinces d’Anatolie orientale. Ces conditions furent rejetées par les chefs tribaux et les cheiks des confréries (propriétaires terriens) en raison de la faible étendue du futur État kurde par rapport à la région effectivement habitée par la population kurde, étendue qui serait par la suite réduite par la création d’un État arménien. Le nationalisme kurde embryonnaire tenta alors de s’unir aux kémalistes qui pour toute réponse, à peine parvenus à consolider leurs positions, étouffèrent – au-delà de la composante marxiste – la dissidence kurde à Koçgiri (1921) et imposeront avec le traité de Lausanne (1923), une révision des accords de Sèvres, fixant les frontières actuelles de la Turquie et, avec elles, laissant le Kurdistan méridional sous mandat britannique.
L’histoire du mouvement kurde se divise en deux grandes périodes : la première, de 1919 à 1990, avec une nette césure en 1946 (la République de Mahabad), et la période du nationalisme proprement dit. La seconde, de 1990 à nos jours, est celle que nous désignerons, à la suite de Hamit Bozarslan, comme la « crise du nationalisme ». Même si, dans une certaine mesure, ils sont plus atténués que dans le reste du Moyen-Orient, ces grands tournants historiques se reproduisent successivement, dans la sphère kurde, au sein des trois fractions de la bourgeoisie à la tête de la société : bourgeoisie terrienne, petite-bourgeoisie intellectuelle et bourgeoisie pétrolière. La première période – sous la domination de la bourgeoisie terrienne – se caractérise par une série de violentes secousses : de 1919 à 1930, dans le Kurdistan iranien c’est la confédération tribale de Shikak – d’abord soutenue puis prise en otage par les kémalistes – qui dirigera le soulèvement ; en Irak, d’abord, le cheikh Mahmoud Barznadji, s’autoproclamant roi du Kurdistan, ensuite la famille Barzani prendront la tête du mouvement ; en Turquie, on enregistre 18 soulèvements en moins de 15 ans (1927-1930 à Ararat ; 1936-1938 à Dersim) ; les Kurdes syriens participeront à la plupart de ces mouvements. L’événement le plus important de cette période c’est la proclamation, le 22 juillet 1946, d’une république autonome en Iran dans le sillage de l’occupation par l’URSS d’une partie du pays ; incapable de mobiliser l’ensemble des Kurdes, malgré la participation effective de nombreux Kurdes de Turquie et d’Irak, déchirée par les conflits intertribaux, la République de Mahabad sera défaite par l’armée iranienne le 15 décembre 1946, avec l’exécution entre autres de son président Muhammed. Le PDK de Mustafa Barzani et ses peshmerga, accourus d’Irak pour soutenir la République, se réfugient en URSS où ils resteront jusqu’en 1958.
Généralement suspectés de connivences avec les puissances étrangères transfrontalières, ces soulèvements sont écrasés avec le concours des pays impliqués : « Aucune des nouvelles bourgeoisies nationales de Turquie, Syrie, Iran et Irak, n’hésita à accomplir son sale métier. La première à se distinguer par sa férocité fut la bourgeoisie turque « progressiste », dirigée par Atatürk sur lequel la Troisième Internationale, semble-t-il [sic! ndr], fonda de grands espoirs […], le kémalisme se déchaîne, entre 25 et 37 dans la sanguinaire répression des insurrections populaires répétées jusqu’à réduire les Kurdes à des « Turcs montagnards » et le Kurdistan aux régions est de la Turquie, grâce aux campagnes de pacification pour lesquelles le gouvernement turc reçut l’efficace soutien de la France. De son côté, la bourgeoisie arabo-irakienne poursuit l’arabisation forcée de la zone pétrolifère kurde de Kirkouk, dans un premier temps avec le soutien de la Grande-Bretagne (43-45), ensuite avec le soutien politique, sinon militaire, de l’URSS, et a pu écraser une importante guérilla. De son côté, la bourgeoisie iranienne, même avec le révolutionnaire de pacotille Mossadeg, ne reconnut pas non plus l’existence d’une question nationale kurde en Iran, et se distingua elle aussi non seulement par une répression ininterrompue et par quelques tentatives de « solution finale » contre le Kurdistan d’Iran, mais aussi par sa participation à la répression des insurrections kurdes de Turquie (en 1930) et a de plus, avec le plus répugnant cynisme, joué, avec la CIA et Kissinger, au « soutien » des Kurdes irakiens en 1975. Enfin, la bourgeoisie syrienne, la plus progressiste de toutes (comme le savent les Palestiniens des camps de réfugiés de Damas), bien que n’ayant pas un réel « danger kurde » sur son territoire, n’en a pas moins expulsé de leur territoire originel 140 000 paysans pauvres kurdes, les remplaçant par des populations arabes et a usé de façon coutumière contre les Kurdes de l’arbitraire administratif, des coups de filet policiers, des licenciements de représailles et autres innovations du… progrès. » (Avec le prolétariat et les travailleurs révolutionnaires du Kurdistan, Supplément aux Quaderni Marxisti, n°3, 1984)
La période 1948-1958 est l’ « ère du silence » : exception faite de quelques secousses locales et du succès électoral local du PDK (80 % des votes) dans l’Iran de Mossadeg, le mouvement kurde semble anesthésié ; ce n’est pas la force de la répression, à elle seule, qui suffit à en donner les raisons. En effet, dans les années 1950 commence un exode rural massif, en particulier dans le Kurdistan turc et irakien où les villes de Diyabarkir, Erbil et Souleymanye voient leur population dépasser les 100 000 habitants. Par l’intermédiaire du développement des réseaux de transport et de la scolarisation du Kurdistan turc – eux-mêmes liés au développement de l’industrie turque – apparaît une petite-bourgeoisie composée principalement d’enseignants et de représentants des professions libérales, mais aussi d’artisans autodidactes. De nombreux jeunes venant de milieux pauvres peuvent alors entreprendre des études universitaires : ce sera cette petite-bourgeoisie instruite – formée en Turquie occidentale, à Istanbul et Ankara, uniques cités universitaires dans les années 50 – qui va réactiver le nationalisme kurde dans les années 60-70 à partir du premier coup d’État en Turquie (1960), donnant au mouvement un caractère plus nettement national-populaire : « Les patriotes de gauche sont parvenus à mobiliser les masses. Leur succès venait de leur capacité à »exploiter certaines difficultés économiques » et à mettre en lumière certaines inégalités (le sous-développement de l’Est, l’insuffisance des fonds d’aide des plans quinquennaux). Il fut également dû à leur capacité à faire cause commune avec les populations frappées par l’expropriation des terres des paysans au profit de l’industrie pétrolière dans la région de Batman. Ils se sont également érigés en défenseurs des paysans et ouvriers de cette région qui revendiquaient d’être employés dans l’extraction du pétrole. Ils sont devenus les avocats des paysans sans terres et des populations, le plus souvent rurales, victimes de la violence des unités spéciales de l’armée » (Özcan Yilmaz, La formation de la nation Kurde en Turquie, PUF, Paris 2013, p. 114). C’est la fameuse « génération 49 ».
Le coup d’État du 12 mars 1971 en Turquie provoque de violentes réactions motivées entre autres par la situation économique. Ce sont les « années d’ingouvernementabilité » qui voient la succession de gouvernements incapables de reprendre en main les rênes de la situation jusqu’au nouveau coup d’État militaire de 1980. Dans cette période, les organisations illégales kurdes se multiplient. Leur composition sociale est presque la même que celle de la période précédente : étudiants et professions libérales, l’âge moyen est plus bas et l’appartenance politique vire au marxisme-léninisme, à l’époque très en vogue parmi les intellectuels européens. À la suite de l’amnistie générale du 26 avril 1974, les Kurdes arrêtés après le coup d’État de 1971 pour crimes politiques sont libérés et ceux qui s’étaient réfugiés à l’étranger reviennent au pays. Naissent alors des formations comme le PSTK (Parti socialiste du Kurdistan turc, qui a pour projet un Kurdistan autonome dans le cadre d’un socialisme turc) et le PKK (Parti des travailleurs kurdes, séparatiste). Les organisations kurdes surgissant dans cette période s’affrontent durement entre elles et aucune (sauf le PKK dans une moindre mesure) ne survit au coup d’État de 1980.
Initialement, le PKK ne regroupe qu’une poignée de jeunes étudiants imprégnés d’un marxisme vague et surtout réunis autour de la personnalité de Abdullah Oçalan (de la génération de 1949). Le caractère de classe revendiqué dans le nom de l’organisation existe uniquement sur le plan verbal et n’est guère qu’un vœu pieux. Le parti, existant officiellement en 1978, affirme viser la libération du Kurdistan de la colonisation turque « soutenue » à l’extérieur par l’impérialisme et à l’intérieur par les féodaux compradores : les chefs de tribus, et les féodaux kurdes appartenant à la bourgeoisie terrienne qui sont désignés comme « la principale cause sociale empêchant le développement national kurde » (Cf. Kurdistan Devrimin Yolu, manifeste politique de l’organisation). Le PKK reprend donc les thèmes d’organisations de type marxiste-léniniste, guévariste, tiers-mondiste, etc., qui avaient, pour le meilleur ou pour le pire, proliféré jusqu’alors en Amérique Latine, en Asie et même en Afrique. Il reprend ces thèmes légèrement en retard alors qu’ils sont déjà dans la courbe descendante. Cela en particulier dans le Proche et Moyen-Orient : « […] la cuisante défaite des armées arabes face à Israël est incontestablement l’événement principal qui clôt définitivement la succession des avancées du nationalisme arabe révolutionnaire, anti-impérialiste et unitaire, dont l’Égypte de Nasser avait été l’avant-garde à la suite de la nationalisation du canal de Suez en 1956 » (Georges Corm, Pétrole et Révolution. Le Proche-Orient pendant l’âge d’or, Jaca Book, Milano 2005). Bien que sur une longue période les conséquences de ce retard se fassent sentir, elles ne furent pas immédiatement perceptibles. À partir de 1978, l’organisation est suffisamment forte pour se lancer dans la « guerre révolutionnaire » contre les « féodaux » ; dans cette phase, ses actions consistent principalement en homicides (tentés ou réussis) de chefs de tribu, tout en n’excluant pas la participation aux élections municipales (le premier élu du PKK date de 1979 à Batman). À l’époque, la « guerre révolutionnaire » est étendue aux organisations rivales ; les affrontements entre le PKK et le KUK (Libération nationale du Kurdistan) dans les régions de Mardin et Hakkari sont parmi les plus sanglants, avec des dizaines de morts. À la suite du coup d’État de 1980, la majeure partie des membres du PKK qui ne parviennent pas à fuir la Turquie seront arrêtés (les documents officiels parlent de 1 800 arrestations, mais la seule prison de Diyarbkir renferme environ 5 000 Kurdes accusés de participation au PKK). Des dizaines de détenus meurent au cours de grèves de la faim.
En 1981, commence à tous les niveaux la réorganisation du PKK à l’étranger, mais du point de vue de la situation internationale, 1979 est l’année décisive : l’Égypte de Sadate reconnaît Israël (accords de Camp David), sanctionnant ainsi la banqueroute du socialisme panarabe. La révolution iranienne à partir des usines et des quartiers populaires porte Khomeini au pouvoir. L’URSS occupe l’Afghanistan. Dans ce sombre panorama la cohérence de ce qui pouvait encore se déployer comme un front anti-impérialiste relativement unitaire fond comme neige au soleil (au grand profit de l’islamisme), la question kurde se trouve prise volens nolens dans les conflits qui opposent les États qui se partagent l’espace kurde, des tensions entre la Syrie et la Turquie jusqu’à la guerre Iran-Irak : aux revendications d’autonomie et à l’orientation anti-islamique des Kurdes iraniens, les ayatollahs répondent par la mitraille (45 000 morts selon les estimations). Le PDK et Komala (1) se replient alors en Irak ; de l’autre côté de la frontière, les Kurdes irakiens – face à l’arabisation de la région de Kirkouk voulue par Saddam Hussein afin de « préserver la nation arabe » – acceptent le soutien de l’Iran. À partir de 1988 (phase ultime de la guerre Iran-Irak) le régime irakien passe à l’extermination systématique, utilisant les armes chimiques (180 000 morts). La persécution anti-kurde est condamnée par les puissances occidentales sans sanctions concrètes jusqu’à la Première Guerre du Golfe. Sur un autre front, en 1979, la rupture des relations diplomatiques avec l’Iran, les tensions avec la Turquie et la nécessité de consolider l’hégémonie alawite et de marginaliser les chiites, poussent Hafez el-Assad (2) à se présenter comme protecteur des Kurdes de la région. La direction du PKK, constituée dans le cadre d’une telle stratégie, rejoint la Syrie pour échapper à la répression de l’État turc dans le cours de la même année. Le régime autorise le recrutement et le PKK s’affirme comme un bon instrument de contrôle du Kurdistan syrien. Dans le Liban de la guerre civile, à ses touts débuts, bien entendu grâce à la protection de Damas, le PKK obtient des bases dans la vallée de la Bekaa où il crée sa première académie militaire. En juin 1983, pour dissuader la Turquie de coopérer avec l’Iran, le PDK irakien signe un protocole d’entente avec le PKK qui autorise ce dernier à organiser la guérilla près de la frontière turque. Le 15 août 1984, le PKK relance la lutte armée en attaquant deux postes militaires turcs. Cela va changer la base sociale de l’organisation : « La guérilla du PKK attire rapidement l’attention des jeunes kurdes qui vont bientôt gonfler ses rangs. Il recrute massivement dans les campagnes, mais aussi dans les cités kurdes, entre jeunes et ouvriers des grandes cités turques et dans certains pays européens, en Syrie et en Libye. Le PKK acquiert un caractère principalement rural » (Ozcan Ylmaz, op.cit., 144). Dans ce sens, il est intéressant d’examiner ce que rapporte Paul White dans son livre Primitive Rebels or Revolutionary Modernizers ? The Kurdish National Movement in Turkey (Zed Book, 2000) au sujet de la base sociale du PKK. Voici un échange entre White et Oçalan lors d’un colloque en 1992 : « (Oçalan) – Les gens qui travaillent soutiennent le PPK : les paysans, la petite-bourgeoisie, la bourgeoisie urbaine. Les patriotes pauvres et la classe moyenne soutiennent le PKK. (White) – Mais quel est le groupe le plus fertile ? Vous avez mentionné divers groupes sociaux. Je crois que le principal groupe, le plus consistant, c’est celui des paysans pauvres, c’est juste ? (Oçalan) – Hé bien, oui, ce sont les principaux soutiens de la lutte. Particulièrement en ce moment ce sont eux qui soutiennent le plus fortement la lutte. Avant le 15 août [1984, ndr], avant les années 80, quand tout a commencé, c’était plutôt les jeunes des cités, les intellectuels, la classe moyenne urbaine » (Paul White, p. cit., p. 156).
En 1985, le gouvernement turc commence à organiser systématiquement la contre-guérilla, d’abord avec la création de milices villageoises, c’est-à-dire avec les tribus qui sont armées contre le PKK. De telles mesures empêchent alors le PKK d’intervenir, à partir de 1987, sur la totalité de la zone montagneuse du Kurdistan turc. À la déclaration de l’état d’exception dans les villes kurdes de la part du gouvernement turc (1987), le PKK, au printemps 1989, répond par des appels à l’action de masse. La « masse » répond favorablement : en 1989, à Silopi, à l’occasion des funérailles d’un guérillero du PKK, le cortège funèbre se transforme en manifestation de protestation. Quelques mois plus tard, l’événement se répète dans la ville voisine. En mars 1990, à Nusayib, un autre enterrement de guérillero se transforme en révolte. Les participants à ces désordres se comptent par milliers et il y a des morts au cours de ces manifestations. Le 20 mars 1990, des dizaines de milliers de personnes reviennent à Nusayib pour protester contre la répression policière. À la fin de 1990, tout le « Sud-Est » est touché par des manifestations de masse. En 1991, le mouvement s’est désormais implanté dans la quasi-totalité des villes kurdes et dans beaucoup de villes turques (Ankara, Istanbul, Adana, Izmir, Denizli). Dans cette période, parallèlement aux manifestations de rue se développe une vraie diaspora kurde dans toute l’Europe, dont la France, l’Allemagne et la Suède sont les principaux pays d’accueil.
Dans les années 1990 – malgré la répression en Turquie et l’exacerbation du conflit infranational entre le PKK et les kurdes irakiens du PDK – la guérilla se développe au-delà des prévisions les plus raisonnables, sur la base de la revendication d’un État kurde indépendant. En 1995, on crée un parlement kurde en exil, dont le siège est en Europe et, si l’objectif de mettre en place un gouvernement local ne se réalise pas, le PKK parvient malgré tout à remplir une série de fonctions étatiques de taxation et d’administration de la justice. Dans la même période, on voit apparaître des « Kurdes légalistes », expressions d’une classe moyenne (dont 62 % possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur) divisée entre la guérilla et la volonté d’un dialogue avec le gouvernement et la « société civile » turque. L’existence d’un courant légaliste dont on ne peut négliger l’influence (même si elle n’est pas directement conflictuelle avec la perspective guérilleriste), en lien avec le bilan négatif de l’offensive militaire avec une haute mobilisation, mais, substantiellement, ne donnant aucune importante « conquête », pousse le PKK à s’engager dans d’autres voies (sur lesquelles nous reviendrons plus loin). Mais à la fin des années 90 le PKK subit la douche froide de la capture d’Oçalan. À partir de cet événement, la période comprise en 1999 et 2005 est relativement calme : la perspective d’intégration de la Turquie dans l’Union européenne met le PKK dans une position délicate, car, objectivement, il n’a aucun intérêt à mettre des obstacles au processus d’intégration, en vertu des avantages vrais ou supposés que les Kurdes de Turquie obtiendraient en termes de reconnaissance. Le PKK proclame donc un « cessez-le-feu » unilatéral, aussi pour éviter l’exécution d’Oçalan. La « longue trêve » est une phase de détente pour la population kurde, mais aussi de mécontentement pour beaucoup de militants du PKK et de conflits internes à l’organisation qui sont résolus par la coercition. Le gouvernement turc n’en atténue pour autant pas son offensive militaire qui à la longue ne peut déboucher que sur la reprise des actions armées du PKK. Depuis 2005, les affrontements entre l’armée turque et le PKK ne se sont jamais interrompus. Parmi les actions du PKK, certaines ont touché des civils (Diyarbakir, le 3 juin 2008 : 5 morts et 68 blessés). Les pressions du gouvernement turc sur les USA ont à la fin permis à la Turquie d’intervenir militairement en Irak, afin de détruire les bases du PKK sur les montagnes de Kandil : le 1er décembre 2007 a lieu la première attaque aérienne ; le 22 février 2008, c’est le tour des troupes terrestres. L’« Opération Soleil » se solde par la mort de 240 « terroristes » et 28 militaires turcs. Les USA revoient leur position et retirent leur accord, ce qui accroît la notoriété du PKK. En mai 2009, Ysar Buyukanit – chef de l’état-major turc en retraite depuis peu – déclare que la Turquie ne réussirait pas à chasser le PKK de ses bases de Kandil, même si elle y envoyait toute l’armée turque.
Jusqu’à aujourd’hui, la condition des habitants du Kurdistan reste, dans la plupart des cas, marquée par la misère : « un déploiement d’investissement » avait promis Ecevit à la fin des années 1990, mais ces déclarations sont restées lettres mortes. Malgré la croissance économique de la Turquie, la zone habitée par les Kurdes est toujours la plus pauvre du pays : « il faut souligner que la disparité entre les régions kurdes et le reste de la Turquie demeure très forte, malgré quelques changements. Le conflit entre le PKK et l’armée turque, qui a détruit l’activité économique dans les campagnes kurdes et, en particulier, l’élevage, a ultérieurement aggravé la situation. […] Actuellement, la population du sud-est (Kurdistan turc) compte 85 % à 90 % de pauvres et le taux de chômage (18 %) est grandement supérieur à celui du reste de la Turquie (11 %). En 2006, les régions kurdes n’ont reçu que 8 % des fonds destinés à stimuler les investissements. En juin 2010, seuls 5 % des entreprises de l’Association des industriels et des hommes d’affaires turcs (TUSIAD) représentant 65 % de la production industrielle turque se trouvaient en régions kurdes » (Ozcan Yilmaz, op. cit., p. 178). L’immigration interne à poussé de nombreux Kurdes à chercher du travail dans les grands centres de la Tuquie occidentale . Même si nous n’avons pas d’informations certaines, on peut penser que les salaires des ouvriers kurdes sont généralement plus bas que ceux des ouvriers turcs. Au cours des dernières années, en particulier en 2010, surtout à l’occasion d’affrontements entre le PKK et l’armée turque, il y a eu des pogroms anti-kurdes, ce qui n’est probablement pas sans rapport – si notre supposition est exacte – avec la pression sur les salaires due à la présence de cette main-d’œuvre à bas coût.
Au-delà des frontières turques, en Iran, après l’ère Khatami qui avait suscité de grandes espérances (et autant de désillusions) autour de l’obtention d’un statut autonome, l’élection de Mahmoud Ahmadinejad en 2005 avait déjà provoqué des secousses dans certaines villes du Kurdistan iranien, accompagnées de quelques actions armées du PJAK (Parti de la Vie Libre pour le Kurdistan, fondé en 1903 par quelques militants du PDK d’Iran). En 2008, la grève générale décrétée en souvenir d’un militant tué en 1989 suscite une grande participation dans les principales villes kurdes. En 2009, les protestations contre la réélection d’Ahmadinejad sont massives et en 2010, quatre activistes sont condamnés. L’élection du modéré Hassan Rohani va atténuer le radicalisme de l’ère Ahmadinejad, tant en ce qui concerne l’anti-américanisme sur le plan géopolitique, particulièrement dommageable pour l’économie iranienne, qu’en ce qui concerne la « main de fer » exercée contre la minorité kurde.
En Syrie, l’expulsion d’Oçalan voulue par Hafez el-Assad marque la fin de l’idylle kurdo-syrienne, pendant que la mort du même el-Assad la rend irréversible. À partir de ce moment, le mécontentement et la volonté de « démocratisation » (mais aussi les sympathies proaméricaines) des Kurdes syriens se manifestent à plusieurs reprises jusqu’aux manifestions de 2011 et à l’éclatement de la guerre civile l’année suivante, pendant que l’opposition kurde gardera une attitude fuyante (dont nous devrons examiner les raisons). En 2004, par exemple, au cours d’une partie de football opposant l’équipe locale de Quamichli (la plus grande ville kurde en Syrie) à celle de Der-ez-Zor, l’intervention policière à la suite de bagarres entre supporters arabes et kurdes provoque sept morts, suscitant une vague de secousses qui touche les villes de Quamichli, Afrin, Damas, et Alep. Les révoltés brûlent les portraits des el-Assad père et fils, et déploient des banderoles kurdes et américaines, appelant à l’unisson : « Kurdistan libre ! »
En Irak, les jours glorieux de la guérilla autonomiste du PDK de Mustafa Barzani sont plus que jamais lointains : « […] la guerre du Golfe a radicalement changé la configuration de la question kurde. Elle a abouti à la création d’une zone de protection dans laquelle les Kurdes irakiens ont pu édifier des institutions qu’ils gèrent eux-mêmes. […] Enfin, la guerre d’Irak de 2003 qui a renversé Saddam Hussein et recomposé l’Irak et l’espace régional a confirmé les Kurdes d’Irak dans leur rôle d’alliés stratégiques des États-Unis. Les Kurdes irakiens ont su gagner une influence sur les Kurdes de Turquie, de Syrie et d’Iran. L’expérience des Kurdes d’Irak influence aussi les autorités turques qui ne peuvent plus ignorer la nouvelle position politique et économique des Kurdes irakiens par rapport à leur frontière » (Sabri Gigerli & Didier Le Saout, Oçalan et le PKK, Maisonneuve & Larose, Paris 2005, pp 385-386). À la fin de la guerre de 1991, la perte de contrôle du gouvernent irakien sur son propre territoire permet au PKK, en plus de de se fournir en armes et munitions, de profiter d’une plus grande marge de manœuvre en Irak. Mais l’ascension du PDK actuel de Massoud Barzani (allié d’Ankara, et non seulement des USA) et avec lui d’une bourgeoisie liée à la rente pétrolière, a rendu la vie plus difficile au PKK. Non seulement en raison des conflits interkurdes que cela a produit, mais aussi de la récurrente apparition de fractions « liquidationnistes » au sein du PKK (nous y reviendrons).
Voilà pour ce qui concerne le passé. À présent, la question kurde fait les premières pages des journaux, surtout depuis que le tristement célèbre Daesh est parvenu à prendre pied en Irak. La presse internationale célèbre l’intervention salvatrice des « Kurdes » au secours des Yezidi du nord de l’Irak. Ce que la presse omet de dire, c’est que les Kurdes en question sont les « terroristes » du PKK ou du PYK, et non les peshmerga du PDK de Massoud Barzani, qui en revanche ont pris leurs jambes à leur cou, ce qui ne change pas le contenu du discours, celui d’un banal frontisme anti-Daesh. Pouvons-nous faire notre ce discours ? La réponse est non. Voyons pourquoi.
Restructuration du capital et dénationalisation de l’Etat
On ne peut comprendre le devenir de la question kurde, ni la trajectoire de ses deux expressions politiques – le PKK en premier – sans prendre en considération la fin de la période d’or des « nationalismes d’en bas » – socialistes ou progressistes – dans les zones périphériques et semi-périphériques du système capitaliste, et ses causes. Cette perspective politico-sociale trouvait sa raison d’être dans la structure mondiale du système capitaliste, qui s’est affirmée dans la période comprise entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la crise de 1973. Basée sur la division entre un « centre » et une « périphérie » – et par-dessus tout sur les rapports rigides, investis nationalement, entre l’un et l’autre – cette structure assignait au centre l’honneur et la charge d’entraîner l’accumulation par un développement industriel intensif et à la périphérie, le rôle subordonné de fournir des matières premières à bas coût. Le « bloc socialiste » avec tous ses conflits internes (URSS vs Chine, etc.) était une zone d’accumulation fermée, exclue du marché mondial, et servait de pôle d’attraction à toutes les tentatives de « déconnexion » (Samir Amin) de la part des périphéries tentant d’échapper au rôle que le centre leur avait assigné. Ces diversifications au niveau des formations sociales ne prenaient de sens – comme il advient à chaque époque du mode de production capitaliste – que dans les rapports réciproques à l’intérieur de la division internationale du travail (« l’économie-monde »), dont la complexe cohérence n’évite en rien la possibilité de conflits internes : « la coexistence de ses différences était permise par le système monétaire international qui laissait une autonomie au mode de régulation national. En effet, la part encore modeste du commerce extérieur dans le PIB, le bas niveau d’intégration financière du fait du contrôle des mouvements internationaux des capitaux, la possibilité de dévaluer dans un système de changes fixes mais ajustables, donnaient un certain niveau de liberté à la politique économique » (Michel Aglietta & Giogo Lunghini, Sul capitalismo contemporaneo, Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 33). Cela autant dans les centres capitalistes que, de manière opposée et spéculaire, dans les périphéries « […] le déploiement des institutions médiatrices avait une coloration nationale, et permettait que puissent se développer des modulations nationales de croissance (ou de sous-développement, ndr) fordiste » (ibid).
La crise des années 1970, commençant avec le choc pétrolier, la fin du « bloc socialiste » et la décomposition du Tiers-Monde en « naufragés » (Quart et Cinquième Monde) et « rescapés » (les pays émergents : Brésil, Chine, Inde, Turquie, etc.) apparaît comme une nouvelle configuration qui – loin d’empêcher ou d’atténuer la polarisation centre / périphérie (le prétendu développement inégal) – la rend néanmoins plus complexe, en la dé-nationalisant. Une structure diversifiée, hiérarchisée par zone s’impose : au sommet, les hypercentres capitalistes liés à la finance et au high-tech, au milieu, une zone intermédiaire répartie entre logistique et distribution commerciale d’un côté, activités d’assemblage et outsourcing de l’autre ; en bas la zone de crise et les « poubelles sociales » animées par toute une économie informelle. Cette tripartition se reproduit de manière fractale à tous les niveaux du monde, jusqu’aux quartiers des villes. (cf. Théorie Communiste & autres auteurs de la communisation, « A fair amount of killings », 2004, disponible sur le web) Le capital financier, comme une sorte de nouveau « capitalisme collectif idéal » mondial, devient le vecteur fondamental de cette reconfiguration, et son inflation (ponctuellement atténuée par les explosions de « bulles ») est le prix à payer pour un nouveau cycle d’accumulation qui a besoin de pouvoir exploiter, transférer ou réinvestir la plus-value partout et là où se manifestent des perspectives majeures de profit : « Aujourd’hui, le grand capital s’installe au-dessus de l’État national, à l’égard duquel il tend à entretenir une relation instrumentale et conflictuelle à la fois. Elle est instrumentale quand il cherche à le plier à ses propres intérêts, soit par l’action directe des lobbies, soit par la discipline des marchés. Elle est conflictuelle quand la dislocation de ses intérêts sur un espace mondial provoque dans les économies des nations, surtout celles à capitalisme avancé, des difficultés économiques mettant en crise la fonction de « capitaliste collectif national » assumée dans le passé par les États » (Ernesto Scrapanti, L’Impérialisme mondial et la grande crise, 2013, p. 10, disponible sur le web). Quoi qu’il en soit, le déclin des « socialismes nationaux » dans la périphérie et semi-périphérie et la restructuration du capital s’identifie, dans la mesure où la mondialisation s’impose – des hypercentres aux zones poubelles, de la création de l’Europe à la prolifération de zones de « balkanisation » – comme un processus de dénationalisation de l’État. Il ne faut, toutefois, pas la considérer de façon téléologique, parce que ce n’est pas un dépassement définitif de l’État-nation par la « globalisation », ni cette dernière n’est le stade suprême, enfin atteint, du capitalisme. L’État-nation est devenu un élément fonctionnel d’un système qui le transcende : « En effet, l’objectif de Bretton Woods visait à prémunir les États nationaux contre les fluctuations excessives du système. Les fluctuations de la globalisation actuelle sont tout autres, puisqu’il est question de mettre en place des systèmes et des modes de fonctionnement globaux au sein des États nationaux, quels que soient les risques que court leur économie. De plus, cette dynamique montre comment les États nationaux ont dû participer à ce processus : l’insertion de systèmes et de modes de fonctionnement globalisés dans un contexte fortement institutionnalisé comme celui des États-nations, n’est pas une tâche facile » (Saskia Sassen, Territorio, autorità , diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, Bruno Mondadori, Milano 2008).
La dénationalisation de l’État constitue un système qui a sa cohérence, qui surdétermine la formalisation politique de la lutte des classes : c’est ainsi que la révolte de certaines populations prolétarisées de l’Amérique centrale et méridionale peut se reconnaître idéologiquement dans l’indigénisme. En Palestine, il est impossible de ne pas faire le lien entre la Seconde Intifada et l’ascension du Hamas. En général, dans l’aire moyenne-orientale, l’Islam politique trouve sa base sociale dans les strates sociales les plus pauvres et, contrairement à l’âge d’or du nationalisme arabe, parvient même à profiter de leurs luttes. En Europe, la sauvegarde du national contre la globalisation surgit nécessairement chaque fois que des entreprises ferment ou vont là où la main-d’œuvre est moins chère, le « problème de l’immigration » devient le « problème de l’Europe » ce qui pousse les « autochtones » de la classe ouvrière vers l’abstention ou vers un populisme plus ou moins distordu (cf. « Pourquoi la classe ouvrière va au Paradis (et à droite) », Il Giornale, 25/04/2012 ; « Grillo, la classe operaia in paradiso alle partire Iva », La Stampa, 30/01/2013).
Tout cela n’a rien à voir avec une prétendue décomposition du mode de production capitaliste qui, laissée à elle-même, conduirait à la « barbarie » (?). L’État Islamique n’est pas un retour archaïque, fruit de rapports sociaux en décomposition, mais une entité politique en adéquation avec l’époque et le milieu qui l’ont produite : c’est l’État dénationalisé en personne, ce qui au Moyen-Orient – en vertu des mêmes raisons qui ont déterminé la montée du nationalisme panarabe – ne peut que vouloir dire, littéralement, État islamique. Du point de vue idéologique, la reconstitution du Califat et la reconquête de Jérusalem se présentent comme une réponse crédible, en tout point digne de succéder à la « nation arabe » comme acteur social et géopolitique ; et – ce qui est encore plus essentiel – cela ne tombe pas du ciel, puisque même le déroulement de la lutte de classe quotidienne, dans la mesure où (et tant que) elle reste prise à l’intérieur des rapports de distribution, trouve son prolongement politique naturel dans la revendication d’une redistribution du revenu qui, dans l’aire méridionale, ne peut vouloir dire que réappropriation et redistribution de la rente. L’existence du prolétariat au sein des catégories du mode de production capitaliste trouve toujours une quelconque forme de « traduction » politique dans un contexte donné, mais il n’existe aucune raison impérieuse pour qu’elle aboutisse nécessairement à un réformisme ouvrier (ou laïc) clairement reconnaissable, ainsi qu’il est advenu dans le contexte occidental (partis de masse, social-démocratie et stalinisme). La sphère de la distribution est ce lieu sonore dans lequel les revendications économiques des prolétaires peuvent se redoubler – en fonction des cas et des contextes – de la revendication politique d’une démocratie totale (le « vrai Eden des droits de l’homme »… et du citoyen) en opposition à la démocratie réellement existante, ou bien d’un ordre équitable et juste, non corrompu, puisque fondé sur la loi divine. D’autre part, que les formes de la lutte des classes tombent dans la religion –– comme on l’a vu dans la Pologne de Solidarnosc en 1980 – n’est pas une spécificité du monde arabe : « la religion est l’opium du peuple » (Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Introduction), certainement, mais seulement lorsqu’elle confirme la lutte des prolétaires à l’intérieur du fétichisme (les rapports de production convertis en rapports de distribution). Ceci n’empêche qu’à l’intérieur de la lutte de classe des prolétaires elle puisse être « la chaîne de l’oppression, le cœur d’un monde sans cœur » (ibid.). Que cela se fasse ensuite au détriment de la condition féminine, et pire encore, des femmes prolétaires, tient au fait que le déroulement de la lutte de classe – chaque fois qu’elle appelle les femmes à y participer, comme conjointes et plus directement comme travailleuses – pose la question de leur (ré)assignation à l’espace domestique et, plus précisément, au rôle de reproduction de la force de travail. Soit dit en passant, ce n’est pas sans rapport avec le « protagonisme » féminin (mise en avant de la figure héroïque de la femme, note du traducteur) dans l’aile militaire du PKK : la guérilla ne supprime pas l’antagonisme de genre, mais le déplace sur un autre terrain, donnant souvent une plus grande marge de manœuvre aux femmes.
Quant à l’État Islamique, il ne fait pas exception à ce qui précède : « En Syrie, l’EI se présente comme un groupe armé efficace qui paye ses combattants, leur donne à manger et assure une redistribution locale aux populations affamées et indigentes. Il s’intéresse particulièrement à la reconstruction éducative pour les plus jeunes. Il accumule des ressources importantes (impôts, contrebande, rançons, pétrole) » (Comment faire la guerre à l’Etat Islamique, sur le site du Monde, 21/09/2014). Même Valéria Poletti – chercheuse indépendante qui a récemment publié une étude sur le Moyen-Orient contemporain, fort détaillée mais traversée de nostalgie panarabe, et qui trouve les raisons de l’ascension de l’Islam politique dans une prétendue stratégie des USA, dont le but serait de provoquer des divisions sectaires au sein de la « nation arabe » – ne parvient pas à retenir quelques lapsus : « […] les islamistes de l’Islamic State of Irak and al-Sham (ISIS en Syrie, émanation directe de l’IS irakien), prétendent combattre l’armée de el-Assad, mais leur but est, de fait, de stabiliser à brève échéance un succédané de califat dans les zones conquises par ses milices. Ils pratiquent donc la terreur contre les civils et prennent les armes contre les combattants, laïcs ou jihadistes, n’appartenant pas à leur faction, du front révolutionnaire. […] l’ISIS […] bien qu’embrassant la vision internationale d’Al-Qaida et partageant la vision extrémiste de domination absolue et l’application intégrale de la charia, n’obtient pas l’approbation de la maison-mère (Al-Qaida, ndr) non seulement pour son intention de constituer un État-califat dans les régions tombées sous sa domination, mais même pour divergences idéologiques. Entre autres, les méthodes terroristes de son système de gestion du pouvoir (rapts, tortures, décapitations, massacres sectaires envers les chiites), qui ont provoqué une profonde hostilité populaire, sont en définitive condamnées par le leader d’Al-Qaida. Malgré cela, si l’ISIS apparaît comme un mouvement jihadiste, il gère effectivement aussi l’administration et garantit le fonctionnement des structures sociales, ce qui lui vaut l’appui d’une partie de la population » (Valeria Poletti, L’incendio del Medio Oriente, le connessioni inattese, 2014, disponibile sul web, pp. 113-114, corsivo nostro).
Du point de vue géopolitique, la dénationalisation de l’État se traduit par la fin du système d’alliances rigide, typique de la bipartition post-1945. A celui-ci se substitue un système d’alliances flexible qui est à l’œuvre actuellement au Moyen-Orient. « Depuis son apparition en avril dernier, l’ISIS a changé le cours de la guerre syrienne. Il a contraint l’opposition syrienne la plus forte à combattre sur deux fronts. Il a entravé l’arrivée des aides en Syrie ainsi que la sortie des informations. Et pour conquérir le pouvoir il a obligé le gouvernement des USA et ses alliés européens à revoir leur stratégie de soutien intermittent à l’opposition modérée et rhétorique qui appelait à chasser le président syrien Bachar el-Assad. Entre temps, des agences de renseignement, dont l’allemande, ont rétabli les relations avec le gouvernement syrien. On peut imaginer une ultérieure réhabilitation du régime d’el-Assad avec la croissance d’Al-Qaida » (Valeria Poletti, op. cit., p. 114). Dans cette pagaille, les alliances et les changements de front sont la règle, et la prudence s’impose. Mais à propos du PYD, allié syrien du PKK, l’auteur de Kurdistan, dans l’œil du cyclone écrit : « Ici, depuis l’insurrection contre le régime syrien, [le PYD] ne s’est aligné ni sur le régime d’el-Assad, ni sur les »rebelles syriens », pratiquant une »troisième voie » consistant à libérer et défendre leur propre territoire pour l’administrer en commun avec d’autres partis et réalités de la société civile, pas seulement kurde, dans une sorte de »démocratie cantonale d’en bas » ». Ce que l’auteur omet de dire c’est que cette prétendue « troisième voie » n’en est pas tant une, étant donné qu’el-Assad l’a permise par une sorte d’accord non écrit sur la base duquel le régime syrien accordait une certaine autonomie au Rojava en échange de la neutralité des Kurdes de Syrie dans la guerre encore en cours. Certes, on peut affirmer – comme le fait la joyeuse bande de Wu Ming dans La guerra all’ISIS, il ruolo del PKK e la zona autonoma del Rojava (disponible sur le web) – que l’autonomie des Kurdes du Rojava s’oriente dans le sens de la confédération démocratique augurée par le PKK, mais à nous, il nous semble qu’elle va plutôt dans le sens de la construction de structures proto-étatiques qui, dans des circonstances particulières, pourraient dans le futur constituer la base d’un État kurde indépendant. En outre, même en admettant que le PKK et le PYD et leur respectives milices seraient entièrement auto-financées (impôts, contributions des immigrés, etc.), reste le problème de la provenance des armes, à travers quelle filière, etc. Par exemple, est-il pensable que les corridors à travers lesquels les armes parviennent aux zones contrôlées par le PKK et ses alliés restent ouvertes sans la tutelle, plus ou moins discrète, d’au moins un des grands États de la région ? Certains prétendent que le PKK et le PYD se fournissent sur le marché noir en Syrie, de déserteurs syriens. C’est peut-être vrai, mais ces armes suffiront-elles aux milices kurdes pour tenir tête à l’État Islamique qui dispose désormais d’une vraie structure étatique, du contrôle de puits pétrolifères et surtout s’est emparé d’une considérable quantité d’armes de l’armée irakienne en déroute ? A ce jour (le 7/10/2014 ndr), ce sont les drapeaux de l’IS qui flottent sur tout Kobane, en Syrie, et le PYD a demandé officiellement des renforts venant du Kurdistan turc : « »la mobilisation pour Kobane est insuffisante, la communauté internationale doit intervenir », a averti, jeudi, Redur Xelil, le porte-parole du YPG (aile militaire du PYD, ndr), sur sa page Twitter. »dans le cas contraire, ce sera un autre génocide, comme celui de Sinjar, mais à Kobane » a-t-il affirmé, faisant référence à la fuite en masse de dizaines de milliers de Yézidis de la région de Sinjar dans l’Irak voisin » (voir le site du Financial Time, 18/09/2014). Que ceux qui ont des oreilles, entendent.
D’autre part, la création d’un camp formant barrage à l’IS s’impose aux intérêts américains, et la recherche de motifs cachés (diétrologia, ndt) des Michael Moore en herbe sur le soutien des USA à l’ascension de l’Islam radical et d’Al-Qaida n’explique pas grand-chose (cf. « Opérazione ISIS, l’obiéttivo è la Cina », »Opération ISIS, l’objectif c’est la Chine », Il Manifesto, 16/09/2014) : même en négligeant la question du contrôle des gisements pétroliers et de gaz, l’État Islamique poursuit le spectacle à base d’exécution de prisonniers occidentaux en tenue « Guantánamo », et Obama n’est pas resté à regarder. Certes, les temps du 11 septembre et de Georges Bush Jr. sont loin, mais, à bien y regarder, le niveau de dégradation des rapports internationaux n’est pas tel qu’il empêcherait l’intervention militaire d’une coalition sous la direction des USA avec tant de « droits humains » pour la légitimer. Comme il est établi que les principales forces laïques de la région sont, malgré leur hostilité réciproque, le régime syrien et « les kurdes », les scénarios futurs pourraient être surprenants (cf. « USA con l’Iran e Turchia con i curdi, quelle strane alleanze contro il Califfo » (« Les USA avec l’Iran et la Turquie avec les Kurdes, ces étranges alliances contre le Califat ») La Répubblica, 02/09/2014). Disons-le clairement : ce qui se profile est un scénario « à la yougoslave », une guerre civile meurtrière et une avalanche de « droits humains » vont tomber du ciel. Dans le cas où un pareil scénario se réaliserait, la question est de savoir ce qui pourrait en résulter : une remodelage des frontières étatiques au Moyen-Orient (avec l’éventuelle création d’un État kurde indépendant), ou bien le déploiement d’un chaos croissant, sans aucune voie d’issue révolutionnaire en perspective (pour le moment du moins) ? Apparemment, l’existence même du PKK et l’implacable opposition de la Turquie à l’octroi de l’autonomie aux Kurdes, sont les principales contre-tendances à la première de ces deux possibilités. Mais en est-il vraiment ainsi ? Et si oui, pourquoi ? Notre réponse est encore une fois négative, et nous exposerons nos raisons dans le prochain paragraphe.
Aucune « solution » – fût-elle révolutionnaire ou contre-révolutionnaire – ne sera en tout cas endogène et géographiquement limitée au contexte moyen-oriental : de nouvelles et durables frontières ne pourront se stabiliser que dans le cadre, beaucoup plus ample, d’une restructuration ultérieure du mode de production capitaliste, dont il n’y a actuellement que quelques rares et vagues signes. Mais, même l’autre terme de l’alternative n’en est pas moins subordonné à ce qui surviendra ailleurs (voir ci-dessus). A notre avis, cela s’inscrit dans la continuité des résultats instables ou funestes des Printemps arabes (Égypte, Tunisie et dans une moindre mesure Libye) allant dans le sens de l’établissement d’une phase de chaos systémique à long terme. « Les trois prévisions géopolitiques avancées par Giovanni Arrighi dans Le Long XXe siècle, se basaient sur l’idée que la fuite en avant dans un néolibéralisme financier aurait seulement prolongé l’hégémonie américaine, et aurait éventuellement conduit à la constitution d’un empire global centré sur l’Europe, à une société de marché mondial ayant pour axe l’Asie, ou bien à un chaos systémique à long terme. Une version accomplie de la première possibilité est probablement à exclure. […] Le développement vraisemblable serait une combinaison de la première et la troisième hypothèse : un concert de puissances en mesure d’empêcher un effondrement financier, mais incapable d’organiser une transition vers une nouvelle phase durable de développement capitaliste. Nous entrons dans une période de conflits sans issue entre un capitalisme affaibli (le leadership des USA, ndlr) et une série de pôles oppositionnels dispersés, à l’intérieur d’ordres politiques délégitimés et frauduleux » (Gopal Balakrishnan, « Spéculations On The Stationary State », in Left Review, n° 59, septembre-octobre 2009).
Le tournant « libertaire » du PKK
Hamit Bozarslan décrit de la façon suivante le désarroi induit, dans le cours des dix dernières années, dans le milieu militant kurde, par les transformations que nous nous sommes efforcés de décrire dans le paragraphe précédent : « Tout concourt à montrer que la contestation kurde rejoint actuellement la fin d’un cycle historique marqué par ses propres modes de socialisation, d’expression, de militance, et jusqu’à ses propres formes de violence. Ce phénomène n’est certes pas nouveau. Dans les années 1960, toute une génération de militants et de combattants nationalistes d’inspiration occidentale, certains déjà actifs dans les années 20, avait laissé la place à nouvelle génération de militants ou de partisans, qui s’identifiaient dans leur écrasante majorité avec la gauche. L’échec de la révolte de Mustafa Barzani en Irak (1960-1975), théâtre de rupture autant que de transmission inter-générationnelle, avait donné à son tour un élan à de nouveaux acteurs, l’UPK (Union Patriotique du Kurdistan) en Irak, Komala (Regroupement) en Iran et le PKK en Turquie, en première ligne dans la lutte armée. […] Aujourd’hui, forts d’une légitimité acquise dans le cours des luttes passées et désormais terminées, ces vieux militants occupent encore des responsabilités dans le Kurdistan irakien, portent aujourd’hui les habits des hommes ou femmes politiques, de bureaucrates ou encore d’entrepreneurs […] Malgré les nuances à prendre en compte en fonction de la situation de chaque pays, pour tout un cycle historique passé, la militance kurde est restée ancrée à gauche, alors que les autres expériences contestataires du Moyen-Orient après 1979 se sont amplement associées à l’islamisme. Aujourd’hui, les effets de la chute du Mur se font sentir au Kurdistan, même si avec un retard de deux décennies, créant une étrange impression de vide. Si la contestation kurde continue à puiser dans un nationalisme encore capable de mobiliser, ses symboles et ses représentations historiques ou géographiques , ces derniers ne sont plus en mesure de légitimer une lutte particulariste avec un discours et un imaginaire capables de les transcender et leur donner un sens ». (Hamit Bozarslan, Conflit kurde. Le brasier oublié du Moyen-Orient, Ed. Autrement, Paris 2009, pp. 22-24).
Le tournant pris au sein du PKK, c’est-à-dire l’abandon de la perspective d’un État kurde indépendant, qui s’inscrit manifestement dans le cadre ébauché par Bozarslan, répond à trois ordres d’exigences : 1) la reconnaissance d’un état de fait : l’obsolescence des « nationalismes d’en bas » ; 2) l’issue négative de la stratégie de la guérilla, symbolisée par l’arrestation d’Oçalan à Nairobi en 1999 ; 3) les transformations sociales advenues dans le Kurdistan historique ces 25 dernières années.
À propos du premier point, l’obsolescence des « nationalismes d’en bas » peut être expliquée à la lumière de la restructuration capitaliste (comme proposé plus haut), mais, plus prosaïquement, c’est une donnée de fait qu’avec la disparition de l’URSS, s’évanouit le principal financement de ces nationalismes. Dans le monde bipartite post-1945, d’une façon diversifiée, mais néanmoins cohérente, les désirs ardents d’indépendance des « nations dominées » et les tentatives de développement d’un capitalisme autocentré dans les pays du Tiers Monde déjà formellement indépendants, mais affectés par « un développement du sous-développement » (la bourgeoisie compradore qui vend à bas coût aux puissances impérialistes pour financer d’abord sa propre consommation, plutôt que d’investir dans l’industrie et la création d’une demande interne qui la soutiendrait) ne pouvaient se réaliser (ni être planifiés) sans l’égide de la Patrie du Socialisme, et de ses crédits à long terme et à bas taux d’intérêt. Le malheur (qui est aussi la dynamique) du nationalisme kurde, c’est de s’être retrouvé sans « saints au paradis », alors que la revendication d’un Kurdistan indépendant équivalait à marcher sur les pieds des stars de l’anti-imperalisme arabe sponsorisé par L’URSS.
Sur le second point, il faut rappeler comment, bien avant son arrestation en 1999, Oçalan s’orientait vers la recherche d’une « solution politique », qui équivalait déjà à revoir à la baisse les revendications historiques d’indépendance, dans l’espoir de remercier les « impérialistes » de l’Union Européenne, qui repousseront ses avances et permettront finalement son arrestation. Le résultat du « pèlerinage » européen d’Oçalan fut reconnu par tout le mouvement nationaliste kurde comme une défaite historique et détermina, entre autres choses, une perte substantielle de militants. On ne peut pas ne pas y ajouter que la crise « spirituelle » du PKK allait de pair avec la cooptation du PDK de Massoud Barzani dans l’orbite des pro-USA, et nombreux sont ceux qui espéraient qu’une telle alliance permette enfin d’obtenir par la voie diplomatique ce que le PKK, avec sa guérilla et son « marxisme », n’avait pas réussi. Les espoirs suscités par la prééminence des Kurdes irakiens aux yeux des USA sont loin, d’autre part, d’être injustifiés, même si la création d’un État kurde ne semble pas à l’ordre du jour : dans les cercles d’études de l’US Army il y a débat sur la perspective d’accorder aux Kurdes un État indépendant (voir l’appendice).
Quant à la transformation de nature purement sociale qui traverse tout le Kurdistan historique, bien qu’il soit en vogue de présenter la dynamique de l’espace kurde comme si elle se déroulait dans un exotique microclimat montagnard, « le contexte des années 2000 se prête difficilement à la comparaison avec des périodes antérieures. La contestation kurde se déploie désormais dans un espace largement urbanisé. Le paysage rural auquel les Kurdes étaient étroitement associés tant dans leur réalité quotidienne que dans celui de l’imaginaire des orientalistes a pratiquement disparu […]. Dans le Kurdistan d’Irak, où les villages kurdes ont été détruits dans le cours des années 1980 par le régime de Saddam Hussein, les trois quarts de la population vivent dans les trois grandes villes, la capitale Erbil, Dihok et Souleimaniye. […] En Syrie, le noyau central des politiciens kurdes s’est toujours battu dans les villes et aujourd’hui plus qu’hier, ce sont l’intelligentsia et la jeunesse qui occupent la scène. En Iran, également, même si le régime n’a jamais pratiqué une politique délibérée de destruction des campagnes kurdes, le poids démographique et politique des zones rurales diminue au profit de dizaines de villes parmi les moins développées économiquement, mais marquées par une grande vitalité. Si la plus grande partie des villes kurdes de ce pays a une population comprise entre 100 000 et 150 000 habitants, Urmia approche les 600 000 habitants. Nous observons la même dynamique en Turquie, où le phénomène tribal fut tellement palpable dans le passé de la résistance kurde.[…] Un autre élément, infiniment plus perceptible que dans le passé, concerne le poids de la diaspora interne à chacun des pays. Si Bagdad a cessé, pour des raisons évidentes, d’être un lieu de concentration kurde, d’autres capitales ou de grands centres prolongent l’espace kurde bien au-delà du Kurdistan historique : Istanbul, où vivent des millions de Kurdes, et une demi-douzaine d’autres villes turques, Alep et Damas, où il y a environ 600 000 Kurdes, ou encore Téhéran. […] Si la présence de plus d’un million de Kurdes en Europe est récente, cette autre diaspora, bien distincte de celle qui vécut en URSS ou dans le monde arabe et particulièrement au Liban, n’en a pas été moins radicalement reconfigurée […], chanteurs pop ou ingénieurs, restaurateurs ou ouvriers non qualifiés s’inscrivent dans un engagement pro-kurde sans pour autant accepter l’emprise d’une organisation sur leur quotidien » (Hamit Bozarslan, op.cit., pp. 20-22). L’affirmation de la Turquie comme économie « émergente » d’un côté, l’intoxication pétrolière du Moyen-Orient de l’autre, créent une fracture entre un Kurdistan urbain et pauvre, mais en expansion, et un Kurdistan rural et montagneux à l’abandon, ce qui a conduit le PKK, au cours des années 1990, à être toujours plus l’expression et l’interprète des revendications du second, laissant le premier aux autres forces politiques.
A la lumière de ce qui précède, il est évident que le prétendu tournant « libertaire » du PKK n’est pas l’Ultime Vérité Révélée que chaque mouvement social devrait faire sienne ; au contraire, il répond à des problèmes spécifiques, c’est-à-dire : 1) un problème de « légitimité historique», lié au déclin des modèles traditionnels de la guérilla marxiste-léniniste ou tiers-mondiste ; 2) un problème de « justification idéologique » face à une défaite historique cuisante ; 3) un problème d’ « adaptation culturelle » vis-à-vis d’un contexte social en mutation. Et c’est ainsi que le PKK chercha à se lier au mouvement altermondialiste (3). Le « mouvement des mouvements », le « peuple de Seattle », fournirent à Oçalan et ses camarades tout le matériel nécessaire pour réaliser le renouvellement théorique et organisationnel imposé par la situation, principalement en ce qui concerne l’articulation d’une perspective qui était et reste la libération nationale, avec le renoncement à l’obtention d’un État kurde indépendant. Dans sa nouvelle source d’inspiration théorique, le PKK trahit alors autant ses points forts que ses points faibles : parmi les premiers, l’efficacité rhétorique qui met au premier plan le changement à réaliser ici et maintenant, la revendication de l’éthique, la critique des hiérarchies, l’éloge de l’horizontalité, un éclectisme théorique (écologie, féminisme, etc.) qui renonce aux synthèses unitaires sentant trop le « marxisme » ; parmi les seconds, une insistance sur l’auto-gouvernement et l’autonomie qui cache le vide programmatique : dans les plus récents textes d’Oçalan traduits en italien – Confédéralismo démocratico et Guerra e pace in Kurdistan (disponibles sur le web) – hormis les appels généraux à une plus juste répartition des richesses (?), on cherche en vain quelles mesures sociales le PKK entend adopter quand l’hypothétique confédération démocratique qu’il annonce verra le jour. Le type de base sociale, le contexte de l’action, les points de référence théorique rapprochent toujours plus le PKK d’une sorte d’EZLN moyen-oriental, mais… encore une fois le PKK arrive en retard sur la scène : le tournant du confédéralisme démocratique a été fait officiellement en 2002, pendant que les protestations se transformaient en révolte à l’occasion du G8 de Gènes en 2001, et marquaient déjà le début du lent déclin du mouvement altermondialiste. Où donc regarder ? Vers qui se tourner ? Une frange du PKK, dirigée par Osman Oçalan (frère d’Abdullah) a la réponse : les États-Unis. D’un autre côté, l’importance du pion kurde sur l’échiquier irakien conduit aussi les USA à envisager la possibilité d’ouvrir une ligne de communication avec le PKK, potentiellement porteur d’un do ut des fructueux pour les parties : d’une part, le PKK devra s’associer aux efforts de « démocratisation » de la région et faire cesser les conflits inter-kurdes, pendant que les USA s’engageraient à lever toute restriction aux activités internationales du PKK et à faire pression pour une amélioration des conditions de détention de Abdullah Oçalan. Osman Oçalan confirmera l’existence de contacts entre le PKK « au niveau local » et les USA : « des rencontres officieuses avec des responsables américains ont été organisées grâce des intermédiaires proches de notre organisation. Il y a eu des formes de reconnaissance mutuelle. Les Américains désireraient gagner la sympathie des Kurdes. De notre côté, nous désirons trouver une solution avec les États-Unis. Nous, nous n’avons pas collaboré avec le régime de Saddam Hussein et nous n’avons jamais gêné les intérêts américains, alors que les Américains ont fait du mal aux Kurdes. Nous connaissons leur rôle dans l’arrestation de Abdullah Oçalan » (Courrier International, 23-29 octobre 2003). L’orientation à adopter face aux États-Unis provoque, en 2004, rien de moins qu’une scission : la fraction d’Osman Oçalan se sépare et fonde le PWD (Parti démocratique patriotique), ouvertement pro-USA : « L’organisation ne considère pas les États-Unis comme un pays colonisateur, mais comme un pays qui a sauvé les Kurdes. […] Pour mieux marquer son soutien aux USA, le PWD enverra une lettre de félicitations au président George W. Bush pour sa réélection » (Sabri Cigerli & Didier Le Saout, op. cit., p. 381). Nous ne reportons pas de telles anecdotes pour soutenir l’existence d’un grand complot qui ferait du PKK l’énième allié secret des USA. Mais il est toujours nécessaire de mettre en évidence : 1) l’ambiguïté et les tâtonnements qui depuis toujours caractérisent le PKK ; 2) le fait que, si vraiment s’ouvrait l’hypothèse d’un Kurdistan indépendant, le PKK se trouverait dans l’incommode position de devoir choisir s’il devrait participer contraint et forcé aux opérations, ou risquer une marginalisation ultérieure et le début d’une autre saison sanglante de conflits inter-kurdes.
Concluons cette partie par une réflexion de fond. Au moins à partir du coup d’État du Baa’th en Syrie (1966) et Irak (1968), le côté subversif de la question kurde résidait dans le fait d’être une contestation émanant de la partition impérialiste du Moyen-Orient et de l’anti-impérialisme pro-soviétique qui prétendait la combattre. Ce qui se produit maintenant nous montre encore une fois qu’un cycle historique s’est conclu et a épuisé toutes ses potentialités internes, y compris celles « de soutenir jusqu’au bout ( c’est-à-dire jusqu’au droit à la séparation et jusqu’à la défaite de son »propre pays ») le droit à l’autodétermination des peuples opprimés pour et avec un but et une stratégie spécifiquement prolétariens » (Avec le prolétariat et les travailleurs révolutionnaires du Kurdistan, op.cit). Aucune détermination historico-sociale ou présupposé communautaire ne représente plus, en soi, un obstacle pour la valorisation. La question nationale demeure, mais par-dessus tout comme une question pour le capital : la révolution communiste ne pourra la résoudre que sur ses propres bases ; dans le cas contraire, la contre-révolution le fera à sa manière, à l’encontre des revendications nationales, soit en organisant la dislocation violente, soit par l’extermination des populations en question. « Le peuple kurde est en grande partie » internationalisé » […] Des millions de travailleurs kurdes sont employés comme main-d’œuvre dans les usines et dans les champs des pays occidentaux développés. Ils ont combattu aux côtés des prolétaires occidentaux avec plus d’acharnement qu’eux, d’autant qu’ils n’avaient rien à perdre. Pour ces millions, qui ont vécu les conditions mûres de la révolution prolétarienne, un retour aux conditions de »luttes de libération nationale bourgeoise » serait un gigantesque pas en arrière ». (Quaderni internazionalisti, « Quale révoluzione per il Kurdistan » ? Tract sur le web). C’est vrai, et cela est vrai aussi pour les prolétaires kurdes non « internationalisés », mais seulement du point de vue de l’abolition des classes, donc du « … mouvement qui abolit… ».
« … le mouvement qui abolit… » : le local, le national, le mondial
Une vaste nébuleuse de « mouvements » – armés ou non, balançant entre banditisme social et guérilla organisée – agissent dans les zones les plus déshéritées du dépotoir capitaliste mondial, et présentent des traits similaires à ceux du PKK actuel. Ils tentent, d’une panière ou d’une autre, de résister à la destruction d’économies de subsistance désormais résiduelles, au saccage des ressources naturelles minérales locales, ou encore à l’imposition de la propriété foncière capitaliste qui en limite ou empêche l’accès ou/et l’utilisation ; à titre d’exemple, on peut citer pêle-mêle les cas de piraterie dans les mers de Somalie, du MEND au Nigeria, des Naxalistes en Inde, des Mapuches au Chili. Même si les discours et les formes de lutte de ces mouvements ne sont pas de simples épiphénomènes, il est essentiel de comprendre le contenu qui les réunit : l’autodéfense. Une autodéfense qui l’on peut considérer comme vitale, mais qui ne se distingue pas, quant à sa nature, de celle qui s’exprime dans n’importe quelle action syndicale visant à sauvegarder le salaire ou les conditions de travail de ceux qui entrent en action. Ce serait comme un tour de passe-passe que de faire passer une lutte salariale, même si elle très ample et très dure, pour un « mouvement révolutionnaire », de la même façon, il est faux de tomber dans la caractérisation de ce type d’autodéfense animé par des populations épuisées, comme d’un mouvement intrinsèquement révolutionnaire. Un tel tour de passe-passe peut naturellement avoir beau jeu de jouer sur la corde morale, opposant d’un côté « les Occidentaux privilégiés » et de l’autre les « damnés de la Terre » déjà prêts à faire la révolution. Mais un tel anti-impérialisme de seconde main est désormais hors d’usage. Qu’on le veuille ou non, nous ne pouvons oublier que ces mouvements se situent fréquemment, non dans un supposé mais inexistant en-dehors de la production et de la circulation de la valeur, mais effectivement à leurs marges, et parfois dans la défense des « petits mondes anciens » (coutumes ancestrales, etc.) que les rapports sociaux capitalistes sont en train de détruire ou ont déjà remodelés. Mais on ne peut vouloir la révolution communiste et être pour la conservation des petits mondes anciens ; parce que s’il est vrai que le capitalisme les déstabilise, sa destruction révolutionnaire ne pourrait elle-même faire autrement. En même temps, il n’y a pas de sens à soutenir leur destruction capitaliste : nous pensons que ces mouvements devront être englobés et/ou réabsorbés (non sans conflits) par le mouvement pratique de destruction du capital, ce qui ne pourra se faire à force de manœuvres politiques (alliances léninistes ou démocratiques), ni par des mesures intermédiaires visant à approfondir la même prolétarisation forcée que le capital poursuit. Néanmoins, un tel processus ne pourra émaner que du cœur du mode de production (ce qui ne veut pas dire « Occident »), et non de ses marges. On ne peut mettre de côté l’extension toujours mondiale du système capitaliste et sa hiérarchisation : ainsi, une caissière, un enseignant ou un ouvrier, bien qu’étant tous des travailleurs salariés, n’ont pas la même possibilité d’intervenir sur la production de plus-value, de la même façon, une crise insurrectionnelle n’a pas la même portée et les mêmes conséquences sur le plan mondial, si elle a lieu au Kazakhstan ou en Allemagne (la question de savoir quel est le « maillon faible » reste d’actualité).
La seule crise sociale locale qui avait réellement préfiguré ce qui pourrait être un processus révolutionnaire de nos jours et l’impossibilité du rapport capitaliste à se reproduire, c’est l’Argentine de 2001 : un grand pays (à la différence de la Grèce en 2008), industrialisé, relativement « avancé », qui se retrouve d’un jour à l’autre au bord du gouffre à la suite d’une crise monétaire. Dans le mouvement qui a suivi le crash, tous les « auto-logies » (auto-organisation, autonomie, autogestion) ont révélé leur contenu purement défensif, parce qu’on s’auto-organise toujours sur la base de ce que l’on est à l’intérieur du mode de production capitaliste (ouvrier de telle ou telle entreprise, habitant de tel ou tel quartier, etc.), alors que l’abandon du terrain défensif (« revendicatif ») coïncide avec le fait que tous ces sujets s’interpénètrent et que les distinctions s’évanouissent, puisque commence à se défaire le rapport qui les structure : le rapport capital/travail salarié. Ceci est vrai à tous les échelons, ainsi qu’au niveau mondial : une crise sociale générale n’est pas la somme de crises locales évoluant en parallèle, sans se toucher. Dans les crises insurrectionnelles ou pré-insurrectionnelles ayant atteint un certain niveau d’extension, les insurgés de tel pays seront contraints – par la nécessité même de poursuivre le conflit – à chercher un soutien au-delà de ses frontières nationales, ou à franchir en masse (ou dispersés…) ces frontières pour soutenir ailleurs l’insurrection. C’est ainsi – matériellement, et non sur la base d’appels abstraits à l’internationalisme – que la révolution détruit la séparation et unifie l’humanité. Le communisme ne peut être une « confédération démocratique » étendue à toute la planète, pour la simple raison que la confédération présuppose encore la nation comme sujet qui se fédère : notre patrie est le monde entier, certes… mais un Kurde reste pour toujours un Kurde et un Méridional reste… un cul-terreux. C’est une simple juxtaposition de différences, et c’est encore trop peu.
Face à la banqueroute du marxisme et des socialismes réels, il n’est plus de mode de célébrer le développement des forces productives, et une idéologie antiproductiviste, opposée et parallèle, a pris le dessus dans le milieu de la « critique anticapitaliste ». Mais la célébration des mouvements particularistes présente une contradiction dans les termes, dès lors que l’on considère le point de vue de l’observateur qui les célèbre, lequel – étant généralement parti les chercher à l’autre bout du monde – est tout autre que particulariste. C’est la contradiction de l’anthropologue qui s’en va étudier les habitants des îles Trobriand et prétend que ce n’est pas l’impérialisme qui l’a porté là.
La signification historique du capital ne réside pas dans le développement des forces productives, mais dans l’interdépendance mondiale qu’il a créée. Dans ce fameux passage de l’Idéologie allemande sur « le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses », Marx célèbre l’avènement d’une histoire mondiale générée par le mode de production capitaliste et ajoute : « sans cela : 1) le communisme ne pourrait exister que comme phénomène local ; 2) les relations humaines n’auraient pu se développer comme puissances universelles […] ; 3) L’extension des échanges abolirait le communisme local. Le communisme n’est concevable que comme l’action simultanée des peuples dominants, tous en même temps […] » Dans ce sens – sauf à penser qu’il soit possible de faire « l’anarchie dans un seul pays » comme il fut un temps où on voulait faire le socialisme dans un seul pays – la question permettant de déterminer si le PKK, l’EZLN ou d’autres organisations de la lutte actuelle sont ou non « révolutionnaires » est un faux problème : il n’y a aucune continuité organisationnelle des luttes actuelles à la révolution, et cela pour la simple raison que le sujet qui s’organise ne sera plus le même. La question est toute autre : il faut voir les dynamiques contradictoires d’une réalité sociale donnée et des luttes – desquelles telles ou telles organisations peuvent, au mieux, être la formalisation –, et à quelles ruptures elles peuvent éventuellement donner lieu. Ce sont les conditions du problème. Hic Rhodus, hic salta !
NOTES
(1) Organisation politique kurdo-inanienne.
(2) Représentant du groupe religieux alawite, secrétaire du Parti Baa’th Arabe Socialiste (nationaliste) et président de la Syrie de 1971 à 2000 ; père de l’actuel président Bahar al-Assad.
(3) Qu’il y ait des relents altermondialistes dans le PKK et l’YPG vient à point pour revitaliser leurs propres fantaisies sur un capitalisme à visage humain, et c’est au professeur Sandro Mezzada de l’illustrer, dans un récent article intitulé Kobané est-elle seule ?(disponible sur euronomade .info). Cet illustre professeur de l’Université de Bologne nous explique que dans l’expérience autonomiste de Rojava « nous devons reconnaître les connexions avec notre histoire plus récente, […] les échos de Seattle, de Gènes, du zapatisme,[…] un fil de continuité qui se déroule des révoltes dans le Maghreb et le Machreq en 2011, en passant par le 15M espagnol, Occupy, les soulèvements turcs et brésiliens de l’an passé […] » ; nous devrons donc « nous-mêmes revendiquer ce communisme (sic!), descendre dans la rue et réclamer la défense de Kobane et de Rojava. Réinventer d’ici, matériellement, l’opposition à la guerre ». Réinventer l’opposition à la guerre, certes, mais non sans s’attrister que les interventions de la coalition internationale sont restées « sporadiques et inefficaces ». À quand les appels à l’intervention des troupes sur terre ? Parce que « une intervention de police conduite à travers des bombardements aériens est une boutade. Une action de police qui commence par abandonner le terrain et les personnes sans défense qu’il faut protéger des bandes criminelles, est une folie sinon une faute grave »(Adriano Sofri, Ne l’appelez pas la guerre, le 7 mai 1999).
APPENDICE
L’avenir du Moyen-Orient selon le lieutenant-colonel Ralph Peters [extrait de : Ralph Peters, « Blood borders », in Armed Force Journal, juillet 2006]
« […] l’injustice la plus flagrante dans ces territoires notoirement injustes compris entre les Balkans et l’Himalaya, c’est l’absence d’un État kurde indépendant. Il y a entre 17 et 36 millions de Kurdes qui vivent dans des régions contiguës du Moyen-Orient (l’estimation est imprécise, car aucun État n’a jamais permis un honnête recensement). Par sa population supérieure à la population de l’Irak actuel, même une estimation par défaut fait des Kurdes le groupe ethnique, le plus grand groupe ethnique privé de son propre État du monde. Encore pire, les Kurdes ont été opprimés par presque chaque gouvernement contrôlant les collines et les montagnes sur lesquelles ils vivent depuis Xénophon.
Les États-Unis et leurs alliés ont manqué une colossale occasion de commencer à corriger cette injustice après la chute de Bagdad. État-Frankenstein, composé d’éléments mal assortis, l’Irak aurait dû immédiatement être divisé en trois parties plus petites. Nous avons failli par couardise et manque de vision, contraignant les Kurdes à soutenir avec morosité le gouvernement irakien, comme une sorte de quid pro quo pour notre bonne volonté. Mais, s’il y avait un vote, il ne fait aucun doute : plus ou moins 100 % seraient pour l’indépendance.
Tout comme les Kurdes de Turquie, souffrant depuis longtemps, et qui ont résisté depuis des décennies à une violente répression militaire et à une rétrocession territoriale aux « Turcs montagnards » pour les déraciner et effacer leur identité aux Kurdes. Pendant que le problème kurde entre les mains d’Ankara s’est dans une certaine mesure atténué, une répression s’est récemment – et nouvellement – intensifiée, et un cinquième de la Turquie devrait être considéré comme un territoire occupé. Le refus, de la part des démocraties légitimes du monde, de défendre l’indépendance kurde est un oubli de la défense des droits de l’homme bien pire que ces petits péchés mineurs qui excitent habituellement la presse. De même, même les Kurdes de Syrie et d’Iran, s’ils le pouvaient, ne tarderaient pas à s’unir à un Kurdistan indépendant. Et par-dessus tout, un Kurdistan libre, qui s’étendrait de Diyarkabir à Tabriz serait l’État le plus pro-occidental compris entre la Bulgarie et le Japon. »
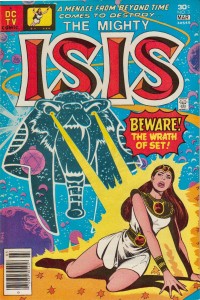

… sur le soutien des USA à l’ascension de l’Islam radical et d’Al-Qaida n’explique pas grand-chose…
J’ignore quelle place exactement est celle des services secrets étatsuniens ou autres et à quels jeux jouent-ils, néanmoins il est de notoriété publique qu’effectivement ceux-ci ne sont pas étrangers à l’essor de Al Qaida, jouant alors contre l’URSS en Afghanistan, guerre au cours de laquelle l’empire soviétique connut son ultime enlisement. O.B.Laden était saoudien, or il apparaît aussi que le Qatar et, peut-être plus modestement, l’Arabie Saoudite, participent ou ont participé jusqu’à une date récente au financement de Daesh, chose qui semble difficile sans l’aval étatsunien. Il semble probable que les différents acteurs étatiques essaient de tirer parti de la situation qu’ils n’ont pas générée mais qui leur permet de produire un rapport de force, en affaiblissant le ou les adversaires (ici, USA,Israël,A.Saoudite,Qatar/Iran,Syrie, Liban(Hezbollah)Russie) sans parvenir à re-stabiliser la situation, comme cela a pu être le cas dans des périodes maintenant assez lointaines (cf.les innombrables interventions des CIA et Cie en Amérique du Centre et du Sud, et même, bien entendu contre le Black Panther Party à l’intérieur même des USA, les connivences avec les Colonels Grecs, avec les généraux Chiliens et Argentins, Guatémaltèques…, avec le pouvoir Italien lors de la lutte contre le communisme-terrorisme…)
Autre chose : »Même si les discours et les formes de lutte de ces mouvements ne sont pas de simples épiphénomènes, il est essentiel de comprendre le contenu qui les réunit : l’autodéfense. Une autodéfense qui l’on peut considérer comme vitale, mais qui ne se distingue pas, quant à sa nature, de celle qui s’exprime dans n’importe quelle action syndicale visant à sauvegarder le salaire ou les conditions de travail de ceux qui entrent en action. »
Je pense qu’il une différence de taille, en tout cas dans le cas Mapuche cité dans ce texte, il s’agit de défendre, oui, mais des terres essentiellement, et ce ne sont pas des ouvriers en tant qu’ouvriers, ce sont des Mapuches et leurs éventuels alliés en tant que tels, j’ai comme l’impression qu’il y a une gêne à considérer ce genre de mouvement de défense des terres, ces » petits mondes anciens », qui ne sont pas « révolutionnaire » parce que : » Mais on ne peut vouloir la révolution communiste et être pour la conservation des petits mondes anciens ; parce que s’il est vrai que le capitalisme les déstabilise, sa destruction révolutionnaire ne pourrait elle-même faire autrement ». Ce qui ressemble de très près à : « L’Angleterre a une double mission historique à remplir en Inde : l’une destructrice, l’autre régénératrice -l’annihilation de la vieille société asiatique et la pose des fondations matérielles de la société Occidentale en Asie »*, autrement dit c’est bien joli tout ça, mais il va falloir PASSER par-là, même si :
» En même temps, il n’y a pas de sens à soutenir leur destruction capitaliste : nous pensons que ces mouvements devront être englobés et/ou réabsorbés (non sans conflits) par le mouvement pratique de destruction du capital, ce qui ne pourra se faire à force de manœuvres politiques (alliances léninistes ou démocratiques), ni par des mesures intermédiaires visant à approfondir la même prolétarisation forcée que le capital poursuit ».
Mais que veut dire « soutenir leur destruction capitaliste »? La meilleure façon de la soutenir est l’absence de mouvement d’importance partout ailleurs et oui aussi chez les « Occidentaux privilégiés ». Ceux qui savent l’avenir de ces mouvements : « englobés » « réabsorbés » savent également qui est ou n’est pas révolutionnaire.
Sera révolutionnaire un mouvement du » coeur » du mode de production capitaliste, peut-être, mais quel intérêt cela présente-t-il, aujourd’hui ce genre de perspective?
La question posée comme « il fallait passer par-là » (destruction des communautés anciennes, colonisation, destruction de la nature etc…) n’a pas de sens hors de son cadre étroitement ethnocentré, parce qu’elle a réponse à tout dans « le sens de l’histoire », et l’établissement rédempteur du socialisme puis l’avènement du communisme. Maintenant cette doxologie cache mal un sentiment d’irréductible culpabilité Occidentale face à la situation créée par le développement de l’Europe puis des Etats-Unis, dont l’impuissance des mouvements sociaux sont l’une des conséquences les plus visibles.
La période actuelle a en effet mis à nu les bases matérielles et leurs caractères idéologiques, chaque groupe devant s’affronter à tout ce qui a permis à l’édifice social de se maintenir et de se renouveler: religions, genre, races, place et rôle dans l’histoire du MPC.
Il me semble vain pour cela d’émettre des considérations sur les Mapuches (à savoir « révolutionnaires » ou » réactionnaires-conservateurs ») ou autre luttes tant que l’on a rien à faire avec ou pour ou dans ces luttes.
Ici l’Europe, Hic Rhodus Nunc** Salta.
* K. Marx in « Sur les sociétés pré-capitalistes, textes choisis de Marx, Engels, Lénine, Ed. Sociales, 1970, cité par Edward Saïd : L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, Seuil, 1980,p 179.
** Nunc= Maintenant.
la version en allemand
http://www.kommunisierung.net/spip.php?article30