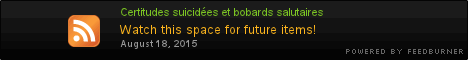Après que ma mère nous fut apparue puis disparue sous les traits d’une prostituée, la fois suivante où nous la verrions nous révélerait que, pendant nos recherches, elle ne se contentait pas d’en utiliser les traits... elle en empruntait aussi les talents.
Mon frère avait trouvé sa compagne de galère, la drogue ; mon père la sienne, la paranoïa. Je cherchais pour ma part ce qui allait me réconforter, mais il y eut tellement à faire avec leurs propres copines que je n’eus pas le temps de chercher mon allié. Mon emploi du temps de lycéenne s’est considérablement chargé à partir du moment où je pris la décision que ma famille ne s’autodétruirait pas sous mes yeux. Je participais aux recherches que mon père entreprenait mais il était difficile de le contenir dans les limites de la raison. Il ne m’était déjà pas facile de démêler par moi-même le vrai du faux, mais quand mon père y mettait son grain de folie, tout menaçait de flancher. Ses théories, ses carnets de notes, ses dossiers envahissaient peu à peu toute la table de la salle à manger ; un malheureux bordel qui ne tenait debout qu’à la faveur de la volonté de mon père. Une faille dans son système de croyance, et la table n’aurait pas tenu le choc.
Tom, lui, menait sa vie comme il l’entendait, ou plutôt de la manière qui lui permettait de survivre dans une souffrance qu’il tentait de rendre relative. Au fond, nous en étions tous là, chacun à sa façon. Tom était quelqu’un de très sensible, mais ne se permettait aucune mise à nu. Plutôt qu’accepter son malheur et se reconnaître en souffrance – quitte à verser quelques larmes – il préférait fuir la maison et casser des voitures. Quand il ne cassait pas le nez de quelqu’un.
Il ne me parlait plus vraiment. Jusqu’à la disparition de notre mère, nous avions toujours été très proches et complices. Nous étions capables de nous comprendre d’un simple regard. Les débordements de notre mère pendant l’enfance nous avaient conduits à développer des modes de communication différents. Je me souviens des regards que nous échangions quand nous rentrions de l’école et trouvions notre mère bourrée. Elle ne supportait pas que nous lui fassions remarquer ou que nous lui montrions que nous avions compris son état – je pense qu’elle s’en voulait et qu’elle croyait pouvoir nous le dissimuler. On croit toujours pouvoir passer à travers avec les enfants. Nous imitions parfois la grimace grossière qui déformait anormalement sa bouche quand elle était “ennuyée” ou confuse, un état indéfinissable qu’elle ne rencontrait que dans l’alcool. Quand celle-ci venait lui coller à la face, Tom et moi ne pouvions retenir nos fous rires, ce qui avait le mérite de créer des îlots de répit dans cette mer d’alcool triste d’où ma mère sortait pour joindre son rire aux nôtres. Elle ne comprenait heureusement jamais l’objet de notre hilarité, mais l’alcool amplifiant les excès d’humeurs, elle pouvait passer des larmes au rire en un clin d’oeil ; l’inverse étant tout aussi vrai !
L’époque des rires complices avec Tom me rendait étonnamment nostalgique d’un temps que je me suis escrimée à oublier. A croire qu’on finit par préférer le mal au pire. L’alcoolisme de ma mère ayant été, à ce stade, surmonté et survécu, et l’âge d’or faisant toujours partie du passé, on croit que le bonheur est derrière soi quand on est confronté à une difficulté encore inconnue. Je ne pense pas que ce soit vrai en soi, mais quand un problème a été résolu une fois, il effraie moins et paraît presque préférable à une situation comparativement aussi difficile mais dont la résolution est encore hors de portée. Tom ne me considérait plus comme sa meilleure amie – ou qu’en de très rares occasions qui ne manquaient pas de faire naître en moi l’espoir idiot du retour de l’âge d’or. C’est à peine si j’étais encore sa soeur. Mon père, dans sa pourtant trop grande tolérance, lui apparaissait comme l’autorité mal intentionnée, et je le suivais de peu dans son échelle d’estime.
Dans ce contexte qui voyait se détricoter tous nos liens (liens qui nous rattachent entre nous, mais aussi ceux qui nous lient à la raison) chacun faisait sa propre cuisine pour tenir le coup. Malgré l’autisme qui nous guettait tous, toute notre attention se maintenait dans la direction inconnue de ma mère. Car où regarder? Nos recherches n’avançaient guère et je priais pour qu’on la retrouve avant que les choses ne dégénèrent à la maison sans possibilité de regarder dans le rétroviseur pour faire un peu marche arrière. Jusqu’où pourrions-nous aller? A quel stade peut-on dire qu’on touche le fond? Et y a-t-il un fond? Il y a de quoi être pris de vertige quand on ne voit pas la fin de sa chute, et il tarde alors de toucher le fond. Car quand on est au fond, on sait au moins où l’on est !
La chute collective que nous faisions dans notre puits sans fond sembla prendre fin quand mon père obtint l’adresse à laquelle étaient domiciliés ma mère et son nouveau mari. Lorsque nous eûmes confirmation de celle-ci, nous comprîmes qu’à de nombreuses reprises nos recherches auraient pu nous faire croiser ma mère au détour d’une rue. Cette idée était troublante, mais nous savions enfin où la trouver et ce fût un soulagement immense. Il fallait maintenant entrer en contact et ce ne serait certainement pas chose simple ; nous ne savions pas à qui nous aurions à faire. Comment aborder un type décrit par ma mère comme une montagne brute? Un ancien légionnaire, qui plus est !
Il fût vite décidé que le samedi suivant nous irions sur place constater l’étendue des dégâts et tenter de raisonner ma mère. Du moins pensions-nous qu’il ne s’agirait que de cela. Tom ne voulait pas être du voyage. Je crois qu’il évitait de se confronter au risque de nouvelles souffrances et c’était beaucoup mieux ainsi. Mais à nous seuls, mon père et moi n’étions pas de taille, au sens propre du terme, à nous mesurer à un ancien légionnaire bâti comme une armoire à glace. Et il s’agirait bien ici de rapports de force plus que dans n’importe quelle autre confrontation! Nous demandâmes alors à Souleymane, un jeune voisin turc qui allait à l’école avec nous, qui avait grandi avec Tom et qui était devenu un ami de la famille ayant suivi de près notre évolution, de nous accompagner dans notre périple. Il accepta sans la moindre hésitation. Souleymane était de loin le plus grand et le plus imposant de nous tous, même s’il aurait sûrement l’air d’une petite frappe à côté du légionnaire. Nous ne pouvions faire mieux de toute façon ; nous acceptions fatalement que les Deschaux n’aient pas été avantagés par la nature et la simple présence de Souleymane nous était déjà d’un grand réconfort au cas où l’entretien tourne en vinaigrette.
Nous prîmes la route en début d’après-midi ce samedi de juillet. La chaleur n’était pas encore à son paroxysme à cette époque de l’été commençant. Après avoir conduit un peu plus de cent kilomètres, nous arrivâmes le long d’un canal et la voiture ralentît pour nous permettre de repérer le numéro non loin duquel nous nous arrêterions. Une rangée de vieux immeubles se tenaient les uns contre les autres le long du cours d’eau, comme pour se tenir chaud en prévision de l’hiver ou lutter contre l’isolement généré par les zones boisées environnantes. Cet endroit était très singulier. On pouvait sentir s’y mêler l’odeur fraîche de la bordure d’eau à celle plus discutable des fins de repas que de pauvres familles débarrassaient de leurs toiles cirées décolorées et trouées par l’usure.
Mon père gara la voiture à quelques pas du petit portillon cassé qui menait à l’entrée de l’immeuble, lequel se trouvait un peu en retrait des autres, comme un troufion sortant du rang d’un pas en arrière. Cette configuration permit à la voiture de ne pas être repérée. Mon coeur battait très fort et je pouvais lire l’inquiétude dans les yeux de mon père, lui qui était toujours tellement égal à lui-même. Il fût rapidement décidé que je frapperais seule à la porte, pour n’effrayer personne, Souleymane et mon père ne se présentant que dans un second temps, quand ma mère se montrerait.
Le nom de nos tourtereaux apparaissait sur la boîte aux lettres défoncée mais n’indiquait aucun étage. Nous prîmes les escaliers avec l’appréhension renouvelée à chaque étage franchi de trouver enfin leur nom sur une porte. Les circonstances ne nous ménagèrent pas puisqu’il fallut atteindre le dernier étage pour le trouver sur une porte dont l’encart supérieur droit avait été raboté afin de tenir dans l’espace mansardé.
Respirons un grand coup... Toc toc toc... Rien. Puis, toujours rien... Un regard interrogateur vers mon père : sont-ils là? Mon père avait pourtant repéré la voiture du légionnaire devant l’immeuble. Nul besoin de préciser comment il obtint cette information. Ah! Chut... Je crois entendre un bruit sourd venant de l’intérieur de l’appartement, un peu comme si on ne voulait pas se faire remarquer. Toc toc toc!!! La peur me saisit. Le fait qu’ils n’ouvrent pas de suite me plonge dans des réflexions qui font trembler mes jambes. J’avais presque espéré un instant être venue pour rien. Toc toc toc...
Clic, clac... La porte se déverrouille et s’ouvre à demi. “C’est pour quoi?” Un homme immense, ça ne pouvait être que lui! “Bonjour, je suis la fille d’Agnès. Est-ce que je pourrais la voir?” L’homme reste immobile ; obstruant le moindre rai de lumière venant de l’intérieur, il me dit qu’il n’y a pas d’Agnès ici. Il allait refermer la porte que je retins de la main dans un geste désespéré lorsque j’aperçus ma mère au loin se lever de ce qui semblait être l’angle d’un lit. “Maman!!! C’est Marie!” Je l’entendis prononcer mon nom dans une voix cassée par la fatigue, puis la porte se referma. La rage me gagna. Toc toc toc! “Maman!” Toc toc toc!!! “Mamaaaaaaaan!!!”
La porte se rouvrit finalement. L’homme, passablement énervé, précédait ma mère qui offrait sa tête des grands jours, dans sa panoplie de cernes, cheveux en friche et regard vitreux : une tête désaffectée. Souleymane et mon père m’emboîtèrent le pas, à la grande mauvaise surprise du jeune marié. Nous entrâmes sans demander le consentement de quiconque en précisant notre intention qui se bornerait à la discussion. Ma mère était complètement shootée. Elle ne semblait pas réaliser que nous étions là et parlait de ses papiers de sécu comme si nous nous étions quittés la veille. Par moments, cependant, la conscience retrouvait son chemin dans le dédale de son esprit et lui donnait un air d’abattement mêlé de résignation. D’une tristesse insoutenable, je vous dis! Nous étions installés autour d’une table à toile cirée ; seul l’homme se maintenait debout, près de la porte du petit studio, ses gros et longs bras croisés en signe de méfiance et de fermeture au dialogue, sa façon à lui d’avoir l’impression de dominer la situation. Pour des tas de raisons, nous n’allions pas emmener ma mère de force, malgré le danger qui la guettait de toute évidence ; nous n’étions pas suicidaires, la loi nous l’interdisait, et ma mère n’en faisait pas la demande. Cependant, nous souhaitions avoir une explication, savoir ce qu’il s’était passé pour qu’elle ne donne plus signe de vie. L’homme ne voulait pas discuter, son seul souci était de savoir quand nous partirions. Ma mère était quant à elle trop à l’ouest pour parler. Cette visite fût un échec total. Tout au plus avons-nous pu constater qu’elle était en piteux état, de quoi peupler nos nuits de nouveaux cauchemars. Elle nous reconnaissait pourtant! Par moments, sur la fin de l’entretien, elle sanglotait, toute en retenue – elle qui aime tant les larmes de crocodile – et je remarquais que ses jambes étaient couvertes de bleus. En un sens je comprenais son silence. Qui sait quel traitement lui réserverait son mari pour une parole de trop après notre départ? Elle disait que nous n’aurions pas dû venir. L’homme s’impatientait et ne semblait pas comprendre toutes nos questions. Il recevait tout comme une offense et ne faisait pas la part des choses. Même dans les moments les plus tendus, mon père est capable de lâcher un peu d’humour dans ses paroles, et il est évident que le mari de ma mère ne comprenait rien à cela. J’imagine qu’il avait l’habitude de régler les conflits par la violence. Ce n’était sans doute pas un hasard s’il avait été légionnaire.
Pas la peine d’insister davantage, il valait mieux partir. Mon père fût difficile à décrotter de là, obstiné comme il est, mais j’y parvins en promettant que nous reviendrions leur rendre visite, et en insistant auprès du légionnaire sur le fait que nos visites n’avaient pour but que de resserrer des liens distendus entre des enfants et leur mère. Je serrai ma mère fort dans les bras, tout en pleurant. Elle était incapable de me serrer en retour, tant les médicaments ou les drogues l’avaient amorphiée. Un coup de folie pile à ce moment-là, et j’aurais trouvé un moyen, même extrême, de la sortir de là. Malheur à ma santé d’esprit!!! Si seulement j’avais pété un plomb!